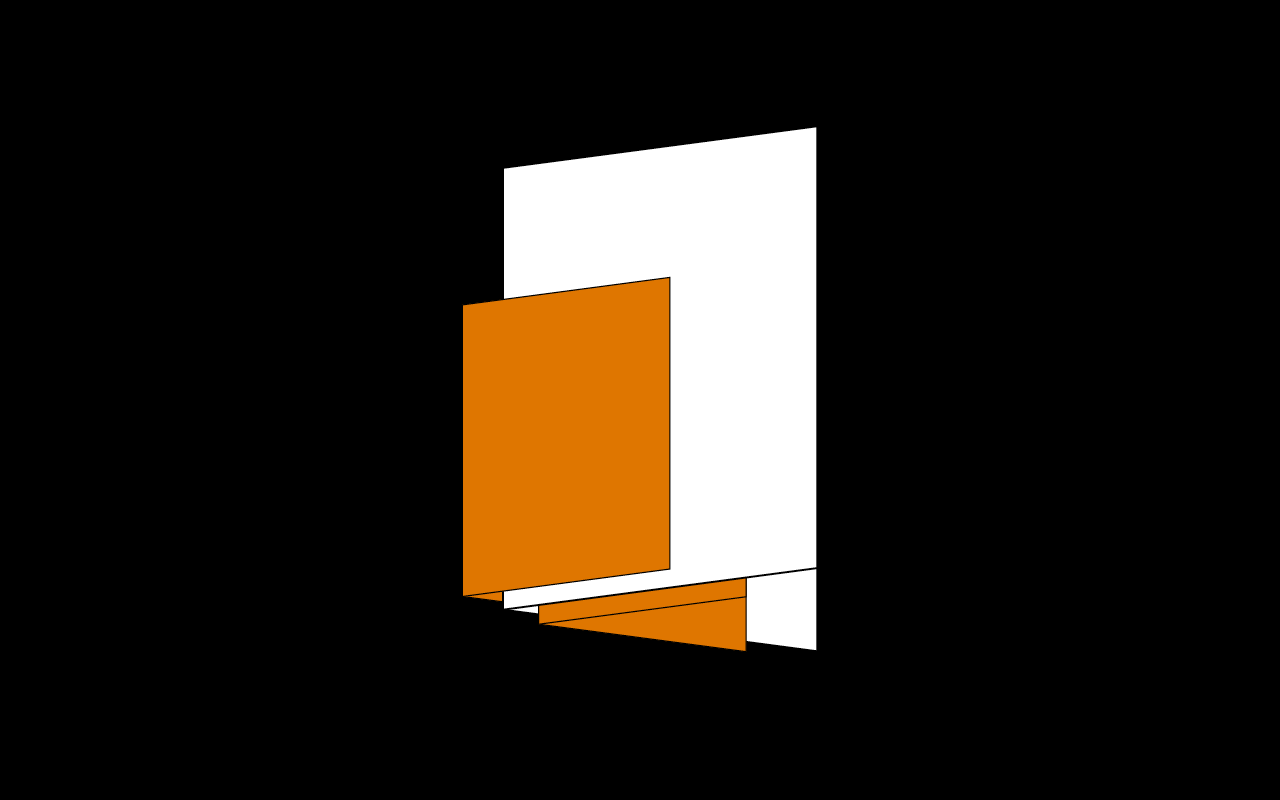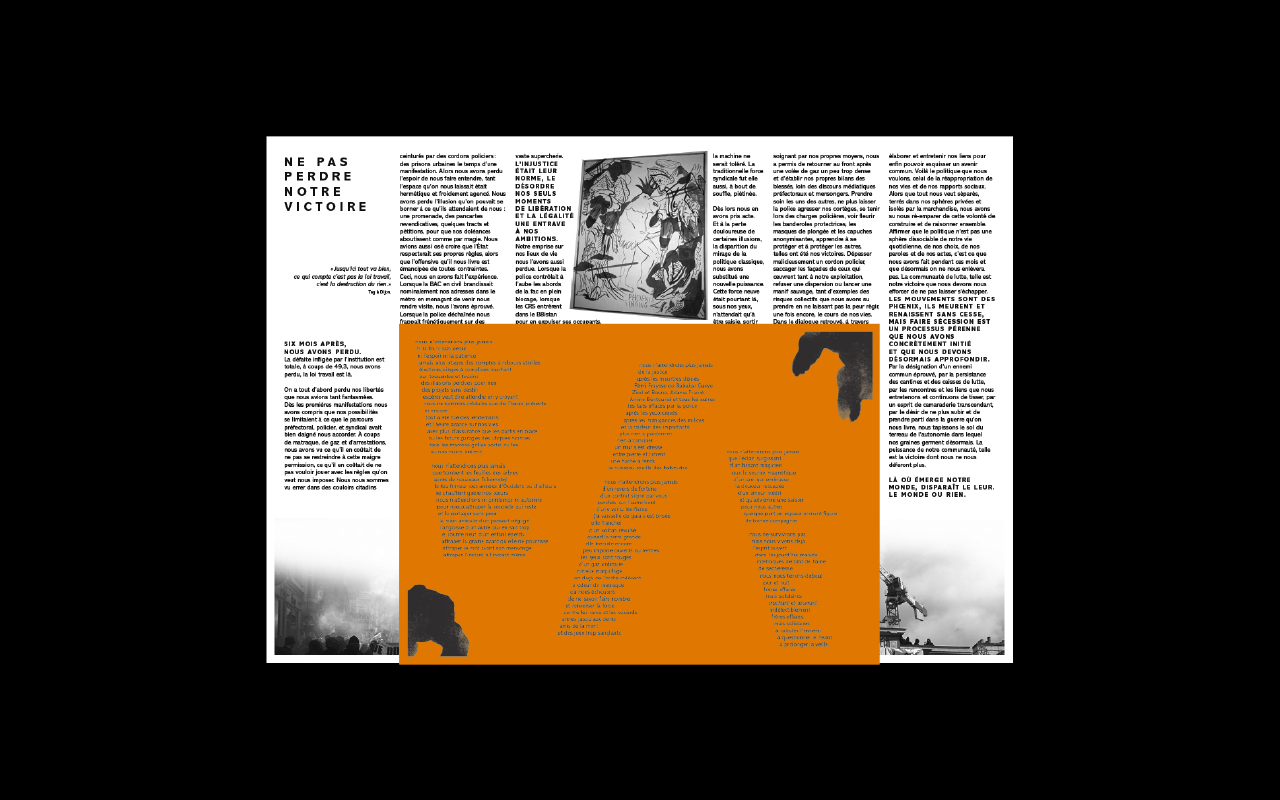Vidéo :
pas de vidéo pour cette livraison, on est sur un gros coup pour la prochaine.
Audio :
Publication :
(fichiers à imprimer)

Glossaire Ingouvernable
Terrorisme
1. Ultime spasme d’un pouvoir agonisant obligé d’alimenter une figure cauchemardesque pour justifier son propre maintien. Étymologiquement, le terrorisme prend ses racines dans le droit romain avec le jus terrendi, c’est à dire le droit d’inspirer aux citoyens une certaine terreur pour le dissuader d’enfreindre les lois. Le « terrorisme » originel était donc impérial. Sa notion contemporaine s’est uniformisée au XIXe siècle en désignant tout ce qui s’attaquait directement aux gouvernements. Dès lors, le mot n’est plus utilisé que de manière unilatérale pour englober, sous une même appellation, toute action, attentat, lutte, mouvement, qu’ils soient politiques, religieux, ou idéologiques allant à l’encontre des gouvernements. Cette notion devient donc un mot-valise permettant d’emblée d’ôter tout caractère revendicatif à une action, en figeant son essence dans la violence aveugle, arbitraire et inexplicable. Ce tour de passe-passe sémantique permet de disqualifier sous la même étiquette « terrorisme » des choses tout aussi différentes que le djihadisme, les indépendantistes, les manifestants trop turbulents ou encore les écologistes radicaux. On fait donc régner dans l’imaginaire collectif une impression d’hégémonie du terrorisme (monolithique et homogène) contre le pouvoir. Ceci permet tout d’abord de s’épargner la peine de tenter d’expliquer et de comprendre des actes différents, mais aussi d’agiter un ennemi commun omniprésent et menaçant, pour légitimer un durcissement des mesures autoritaires et restrictives. D’une main, on lance des guerres saintes meurtrières contre un ennemi visible ; de l’autre on traque et on fait s’incarner l’ennemi intérieur invisible dans ce qu’il y a de plus grossier. Le terrorisme est l’argument du pompier pyromane pour continuer son jeu macabre. Plus question de parler d’attentats avec des visées et des motivations différentes, nécessitant des traitements différents, tout est regroupé sous la même houlette impliquant une réponse globale, générale, urgente. Aux yeux de tous, l’anti-terrorisme est devenu un mode de gouvernement dont l’instauration de l’état d’urgence est l’émanation la plus criante. Comprenons-nous bien : en France, désormais tout ce qui résiste ou déplaît aux menées de l’État est en passe d’être traité de « terrorisme ». Le pouvoir ne protège personne mais se protège de tous. Des interdictions de manifester aux assignations à résidence,
des armes à feu pour contenir les manifestations aux militaires qui paradent quotidiennement dans nos rues, de la surveillance de nos communications aux caméras qui prolifèrent, nous sommes, aux yeux de l’État, tous des terroristes potentiels.
2. « Cette démocratie si parfaite fabrique elle-même son inconcevable ennemi : le terrorisme. Elle veut, en effet, être jugée sur ses ennemis plutôt que sur ses résultats. L’histoire du terrorisme est écrite par l’État, elle est donc éducative.
Les populations spectatrices ne peuvent certes pas tout savoir du terrorisme, mais elles peuvent toujours en savoir assez pour être persuadées que, par rapport à ce terrorisme, tout le reste devrait leur sembler plutôt acceptable, en tout cas plus rationnel et plus démocratique. »
G.Debord.
Pouvoir d’achat
En son absence, des creux d’estomac et des cheveux qu’on s’arrache. En sa présence, une confusion existentielle terrifiante entre être et avoir. Nous ne savons pas quel est le pire des deux. C’est le pouvoir le plus décevant jamais inventé.
Dimitri, 7 ans : « Il est tout naze ce pouvoir ! Même la pâte à modeler c’est plus marrant. »
Nicole, 65 ans : « Ça fait 50 ans qu’on me bassine avec ce pouvoir à la con qui n’a jamais marché ! On m’a complètement arnaquée, le pouvoir que je veux maintenant c’est foutre mon pied au cul à ceux qui m’ont baratiné toutes ces années et qui ont gâché ma vie ! »
Raoul, 83 ans : « Le pouvoir d’achat c’est la licence d’acheter du pouvoir. Avant on travaillait pour subsister et ensuite on allait au bistrot, on discutait, on jouait, mais maintenant on bosse pour pouvoir passer notre temps libre à consommer. Quand je vois tous ces tocards qui taffent pour pouvoir ensuite s’acheter des breloques pour pavoiser devant leurs potes et mieux s’indexer sur l’échelle sociale, j’ai l’impression de voir des esclaves sans maîtres et fiers de l’être… moi je vous le dis, que crève cette société spectaculaire marchande ! Vive le communisme ! »
Élection
1. Les élections consistent en ceci : redistribuer l’autorité
au sein de la société pour que persistent les rapports de pouvoir dans notre manière de penser la politique. Chacun vote pour choisir sur qui et à travers qui il voudrait gouverner, dominer, exploiter. C’est à la fois un abandon de sa souveraineté, une abdication vis-à-vis de sa volonté propre, et en même temps un désir malsain d’exercer néanmoins le pouvoir sur ses congénères. Voilà le méprisable baroud d’honneur de ceux qui s’apprêtent à devenir des esclaves : entraîner les autres dans leur chute. À défaut de fonder sa vie sur sa souveraineté, on tente aujourd’hui de fonder sa souveraineté sur la vie des autres. Le pouvoir est mort ? Vive le pouvoir !
2. Grand classique de la tragédie grecque créé au Ve siècle avant Jésus-Christ et dont nous n’avons malheureusement retrouvé que des fragments disparates. Cette pièce est néanmoins certainement l’une des plus jouées dans le monde et a pris dans de nombreux pays la place d’un rituel reproduit tous les quatre, cinq ou sept ans et auquel une grande majorité de la population participe.
Il s’agit d’une parade d’amour faite par Cratos — hydre féroce des marais — à Demos, naïve orpheline. Les différentes têtes de Cratos charment et menacent successivement Demos, qui, séduite et effrayée par les visages du monstre, finit par accepter de l’épouser. Selon les versions, la période des noces s’avère terrible ou joyeuse, bien que les spécialistes aujourd’hui penchent vers une interprétation pathétique de ce passage. Quoiqu’il en soit, Demos est mangé par Cratos après la nuit de noces dont il résulte tout de même un enfant, Revolutios.
Autonomie
1. L’autonomie est par définition la capacité à définir ses propres règle, s’opposant ainsi à l’hétéronomie, qui est l’imposition de ses règles par un pouvoir extérieur. C’est la forme anti-gouvernementale qui permet réellement le surgissement révolutionnaire, en étant à la fois une soustraction à l’imposition et l’affirmation de ses propres règles. Ceci implique tout d’abord un renoncement, une sécession, et ensuite un combat contre une conception du politique fondée sur le pouvoir d’entités abstraites (l’État, le marché, la nation, la religion…) pour enfin pouvoir inventer ses formes politiques propres. L’autonomie c’est donc le « pouvoir de » et non pas le « pouvoir sur ». Cette perception du politique ne le situe donc pas dans une sphère distincte mais bel et bien dans une vision quotidienne de l’expérience politique. Dès lors, la quête d’autonomie matérielle ne peut être perçue autrement qu’à travers une autonomie politique. Se renforçant mutuellement, ces deux aspects deviennent donc un travail permanent et sont à la fois l’avènement et la condition d’une forme d’auto-organisation collective de nos vies.
2. « Se battre pour orchestrer la musique d’un monde en prenant une place depuis laquelle on ne pourra faire changer ni le rythme ni la nature des sons, ni les instruments des musiciens ne nous intéresse plus. C’est changer radicalement de partition que nous désirons. Inventer une musique qui soit faite d’autre chose que de l’organisation machinale, aveugle, aliénante, déshumanisante de nos existences. »
Comité Érotique Révolutionnaire
3. « Dans notre société, l’Autonomie part de cette élaboration, ou plutôt de la conjonction entre capacité de destruction et de création que les formes de vie autonomes greffées sur des territoires ennemis de la métropole capitaliste sont en mesure d’exprimer. »
Marcello Tari
Travail
1.TRAVAIL TORTURE TRAVAIL TORTURE TRAVAIL TORTURE
LABEUR SUEUR AMERTUME
INSENSÉ SOMMEIL DE L’ÂME
DÉLIQUESCENCE DES OS
SILENCE TONITRUANT DES MACHINES
LE TRACTEUR L’ORDINATEUR L’ASPIRATEUR LA CODÉÏNE
ET LE CRI DU TRAVAIL ET LE CRI DU PATRON
L’ESPRIT S’ENVOLE SE TIRE SE FAIT LA MALLE
ON NE SAIT PLUS POURQUOI
ON FAIT CE QUE L’ON FAIT
MA MAIN M’APPARTIENT
JE LUI AI DIT
JE NE L’UTILISE QUE POUR L’EXQUIS
JE LUI AI DIT
PARFOIS POUR QUELQUES PENNY
PARFOIS !
JE LUI AI DIT
TRAVAILLER C’EST POUR QUAND IL N’EST PLUS RIEN D’AUTRE À FAIRE
2.« Le travail est, par son essence même, l’activité non-libre, inhumaine, asociale. Le travail, c’est la dépossession de la vie au profit d’une fonction machinique de production de marchandises et de valeur, c’est une vente de soi, de son existence, de son temps de vie, de son activité, de son savoir-faire comme marchandise. C’est un esclavage libre, libre au sens où on l’on peut refuser de travailler contrairement aux esclaves, mais comme on a été dépossédé de toute possibilité d’existence en-dehors du Marché, pour survivre, on doit travailler. Comme des esclaves, nous avons une compensation, eux en nature, nous en argent. Comme des esclaves, on nous envoie des forces de répression lorsqu’on se révolte. Qu’on vende des heures d’activité ou notre production soi-disant «autonome», qu’on soit salarié ou ubérisé, nous sommes réduits à des marchandises productrices de marchandises. Notre labeur n’est pas une réponse à nos besoins particuliers ou collectifs, mais une production machinique de marchandises et d’argent. Avec ou sans proxénète, nous sommes tous des prostitués, nous vendons notre cerveau, nos muscles, notre sexe, qu’importe. Nous sommes des robots (travailleurs, en tchèque), des individus réduits à des machines productrices.
Nous n’avons pas peur de cette société de travail sans travail, c’est cette société de travail sans travail qui a peur de nous. »
Comité Érotique révolutionnaire.
Crise
1. Du grec krinein : passer au tamis, séparer le bon grain de l’ivraie et, par extension, juger, faire un choix.
Aujourd’hui : excuse pour un jour sacraliser l’Exception comme impératrice avec ses trois conseillers : le capitalisme, le contrôle et la médiocrité.
2.« Comment avons-nous fait cela ? Comment avons-nous pu vider la mer ? Qui nous a donné l’éponge pour effacer l’horizon tout entier ? Qu’avons-nous fait, à désenchaîner cette terre de son soleil ? Vers où roule-t-elle à présent ? Vers quoi nous porte son mouvement ? Loin de tous les soleils ? Ne sommes-nous pas précipités dans une chute continue ? Et cela en arrière, de côté, en avant, vers tous les côtés ? Est-il encore un haut et un bas ? N’errons-nous pas comme à travers un néant infini ? Ne sentons-nous pas le souffle du vide ? Ne fait-il pas plus froid ? Ne fait-il pas nuit sans cesse et de plus en plus nuit ? »
Gai savoir, §125, Nietzsche
C’est la crise, bébé.
3. Le mot crise, s’il est difficile à définir, ayant une utilisation tant répandue, a pour caractéristique d’avoir été employé pour qualifier quasiment tous les pans de la vie occidentale : ainsi traversons-nous une crise des mathématiques, ainsi nous roulons-nous dans une crise de l’art en nous frayant un chemin par des crises de tous les âges de la vie humaine pour enfin arriver sur une crise sociale, existentielle, budgétaire.
Mais la crise d’or, la palme de la crise, celle qui peut-être, seule, advient ; à l’image d’un cataclysme ou d’une tempête, c’est la crise économique : La « crise » est un dispositif capitaliste qui vise à permettre sa reproduction en période de tension sociale. Repris en boucle par les journalistes et les politiciens pour éviter de nommer autre chose, ce terme devient l’argument absolu à la justification des pires mesures économiques et politiques.
Roger, 54 ans : « La crise c’est comme le terrorisme, on sait pas trop ce que c’est, mais quand ça arrive, on le paye très cher. »
Tels les physiocrates qui laissaient advenir, voire organisaient les disettes pour mieux contrôler le peuple, on peut observer depuis 1973 que le monde est entré en période d’instabilité économique, des crises économiques jaillissant d’un peu partout sans qu’il soit vraiment possible d’établir une date de sortie de la crise. On pourrait même dire que nous vivons dans une superposition de crises et que les États y répondent par des mesures d’austérités provisoires imposées aux peuples (voir pouvoir d’achat) qui, elles aussi se superposent et ne sont jamais levées.
Rappelons que de mémoire Wikipédia, la première crise financière* date de 1637 et était due à une spéculation excessive sur le marché de la tulipe. Nous avons donc ici deux éléments pour comprendre l’origine d’une crise : la déraison et l’absurdité.
*Il convient de distinguer dans crise économique deux causes fréquentes : crise monétaire, qui touche la monnaie et les devises, et crise financière, qui relèvent de la bourse et des banques.
Sécession
Il n’est pas question d’espérer un salut de la politique classique et de ses apôtres, encore moins de vouloir s’emparer de ses trônes vides pour les utiliser comme vecteurs révolutionnaires. Le désert est inhabitable, il nous faut désormais faire naître nos propres mondes. Tout comme le déserteur qui abandonne une guerre qu’on lui impose au nom d’une nation fantasmée, nous quittons ce néant et la société sclérosée. Nous donner la possibilité de bâtir un nouveau navire sur lequel embarquer, avec nos évidences comme seul bagage est la première des étapes. Le processus est long, car notre sécession est à la fois éthique, affective, existentielle — en repensant nos relations par-delà les rapports marchands — mais aussi matérielle — en faisant grandir notre autonomie vis-à-vis de la métropole. Finalement, tout ici se résout à un problème d’équilibre de forces et de mouvements. Il apparaît donc évident de déserter les échelles écrasantes — ici, les grosses machines à pouvoir, puisqu’on ne peut entretenir que deux rapports avec elles de l’intérieur : en devenir un rouage, ou être submergé. À partir de là, faire sécession n’est même plus de l’ordre de l’évidence mais de l’ordre de la nécessité. Cela doit être, puisqu’il n’est pas d’autre choix : souvenons-nous que les grosses machines voulaient nous manger, veulent nous manger, voudront nous manger et nous traquent. La première des choses est de détruire les paradigmes qu’on nous impose et les entraves à notre autonomie ; la désertion est avant tout une soustraction hostile ; partir signifie inventer un ailleurs. Construire des conditions d’existence désirables, des solidarités matérielles et affectives desquelles nous pourrons déployer notre offensive, n’avoir de cesse d’accroître notre autonomie, tels devraient être l’objectif de notre sécession et sa positivité propre.
Puissance et pouvoir
Le plus simple est de partir du territoire.
Le territoire est un fragment d’espace investi par un pouvoir.
Ce peut donc être aussi bien un lopin de terre, que la nuit, qu’une personne.
Le pouvoir est une force mouvante qui circule entre les personnes, entre les choses, et qui vient investir, qui vient prendre le contrôle, accaparer un espace donné, c’est-à-dire empêcher, entraver, se nourrir de l’existence des autres forces qui pourraient se développer sur son territoire.
Donc, on dit : le pouvoir, c’est une conjonction de dominations, de forces bloquantes, vampirisantes qui absorbe ou repousse les autres forces pour se grandir elle-même. De là, s’il est mouvant, ce qu’il va créer pour continuer à se mouvoir, c’est de l’immobilité, de la tristesse, de la résignation. Pourquoi de la tristesse ? Parce que la tristesse c’est, lors de la rencontre de deux forces qui s’entravent, justement ce qui arrive pour la force qui est entravée, celle qui est la plus faible : une réduction de mouvement, un affaiblissement, une perte de puissance. Je rentre dans la mer, je ne sais pas nager : tristesse, pouvoir de la mer sur moi puisque je me fais trimballer, je mange le sable, je ne comprends rien au mouvement des vagues et alors je suis paralysée, figée, j’attends, je me résigne. De là, je suis à la merci du fatalisme, de ma faiblesse.
Le pouvoir aujourd’hui, c’est tout d’abord des machines de pouvoirs, de pouvoirs immenses qui nous forgent, sur lesquelles nous butons ou qui nous butent. Celles-ci s’incarnent dans des structures, institutions et autres dispositifs : « J’appelle dispositif tout ce qui a, d’une manière ou d’une autre, la capacité de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants », nous dit Agamben. Dépossédés de nous-mêmes, le pouvoir s’insémine alors en nous : morale, légalité, aliénation marchande, etc. C’est une force qui investit un fragment d’espace ; on voit très vite que c’est une chose qui arrive tout le temps — à chaque fois qu’on veut imposer quelque chose — que c’est une chose très quotidienne qui est là dans l’injonction, qui est là dans la séduction, dans la fascination, dans l’obligation et il est aussi là dans l’amour, dans l’amitié, dans toute forme de liens en général.
La puissance, c’est la vitalité, c’est tout ce qui vient ouvrir, tirer hors de la mort, hors du chaos. On peut dire que le pouvoir est une forme de puissance en ce qu’il fait, et en ce que, comme elle, il tend à s’exercer et à s’augmenter. Ce serait une forme égoïste de la puissance : il vient ouvrir… pour lui, il se tire hors de la mort, il se tire hors du chaos. Le pouvoir c’est donc toujours un mouvement qui se pense seul, qui se suffit, qui se sent exhaustif, accompli. Il ne survit, il n’est une puissance que parce qu’il circule, que parce qu’il change de contenu, qu’il circule à l’intérieur d’un territoire.
La puissance — pour donner un exemple qui ne serait pas celui du pouvoir, pour dire comme elle peut être autre chose, très différente — est basée sur la joie. Qu’est-ce que la joie ? Ce sont deux forces qui se rencontrent, qui fonctionnent ensemble et en forment ainsi une troisième. Deleuze en donne de très bons exemples : « Il y a toutes les tempêtes possibles, dont on apprend, en lisant Conrad, qu’elles sont extraordinairement diverses. Un bon capitaine c’est, suivant la nature de la tempête, celui qui met son bateau à la vitesse et dans la position par rapport à la vague la meilleure, pour que le mouvement de la vague et le mouvement du bateau se composent, au lieu que le mouvement de la vague décompose le mouvement du bateau. Savoir danser, c’est la même chose… Savoir danser, c’est précisément présenter son corps sous l’aspect sous lequel il se compose, en termes de danse, avec le corps du ou de la partenaire. C’est généralement ça qu’on appelle un rythme. » Qu’est ce qu’il se passe ? Il y a composition, c’est à dire que les forces se joignent et se calent sur le même mouvement, qui est le mouvement de l’une ou de l’autre force, ou qui est un troisième mouvement que l’on invente ; ce qu’il se passe en tous cas, c’est une compréhension mutuelle dans les deux sens de comprendre : entendre et inclure.
Ce que Deleuze va dire c’est que la joie augmente ma puissance et que la tristesse diminue ma puissance. C’est facile a expliquer : d’un côté on a des mouvements qui se décuplent, de l’autre des mouvements qui se réduisent, se ralentissent. Tout l’art alors, va être d’aller chercher ce qui se base sur la joie. Néanmoins, dire que la puissance ne croît pas sur le ressentiment n’autorise pas à congédier tout ce qui est de l’ordre du négatif, du vulnérable et du souffrant, au prétexte que ce serait des « passions tristes ». La destruction est aussi création, la tristesse d’un échec nous renforce, et la profanation des dispositifs de pouvoir et de leur symbolisme est l’affirmation de notre puissance réelle.
Tout cela pour dire qu’il est une force, une manière d’exercer sa force qui ne soit pas ridicule et qui ne tende pas à une hégémonie, ni à une simple perpétuation d’elle-même, puisqu’elle voit son intérêt dans le rapport heureux, dans la conjonction, qui n’investit pas mais qui occupe puisqu’elle cherche toujours le mouvement dans l’espace, puisqu’elle cherche toujours de nouveaux territoires, puisqu’elle accueille les autres forces.
On voit très vite alors que l’inconvénient de cette force est sa précarité, son besoin immense de fluidité quand la moindre tristesse vient ébranler son champ de possible (il faut une certaine grandeur à une force pour tenir les chocs de la rencontre). Son atout sera donc, n’est-ce pas ? sa capacité à se réinventer, à retomber d’échelle, à se découvrir des partenaires de danses dans l’anecdotique comme dans le spectaculaire, dans les aspérités du matériel comme dans les vapeurs de l’ineffable.
Ingouvernable
L’Ingouvernable est un mammifère au pelage soyeux, au cœur éclatant et aux griffes longues. Il mesure entre 1m50 et 2m20 et son poids est variable. C’est un animal de meute, pratiquant la métamorphose, ce qui le rend difficile à identifier. Le plus sûr moyen de le reconnaître est sûrement d’observer son comportement. Il est, en effet, capable d’une polyvalence inégalée dans la nature : il peut nager, voler, escalader et cracher du feu. C’est un prédateur redoutable du poulet et de la vache, s’attaquant parfois aussi aux chiens, aux porcs et aux moutons, ce qui n’empêche pas certains spécimens d’être herbivores. Malgré son système de reproduction encore incertain, il est destiné à être le successeur de l’humanité. Il est sûrement l’une des plus belles créations de la nature.
Commune (vivre la)
Avènement de la sainte trinité « Sécession, autonomie, puissance destituante ». Ces notions sont à la fois les moyens et les fins du processus révolutionnaire, elles s’entremêlent, se transforment, se nourrissent mais ne sont jamais définitivement acquises. La commune consiste précisément en la recherche et la consolidation réelle de ces éléments,
de manière permanente et perpétuelle. Néanmoins, nous avons imaginé de manière graduelle l’enchaînement de ces concepts comme des phases différentes du processus révolutionnaire. Cet ordre n’est évidemment pas figé, il n’est qu’une combinaison parmi d’autres. Pour le dire grossièrement, viendrait dans un premier temps, la sécession qui est la prise de conscience, la sortie et la destruction du paradigme, la nécessité de ne plus être un rouage, de quitter le navire. Pour s’extraire du désert, il faut alors accroître notre autonomie, à la fois matérielle et affective. S’organiser, tisser des solidarités fortes, prendre des espaces, généraliser la débrouille, parvenir à vivre à l’intérieur du désert mais sans lui, c’est-à-dire créer des oasis d’autonomie. Fort de cet ancrage et de cette force, la commune désormais solidement en place peut plus aisément irradier, profaner, attaquer, bref se répandre via sa puissance destituante. Penser, construire attaquer, telle serait le chemin vers notre commune.
—
Nous, Provo, Partisans de la Vocifération
Amsterdam, le 10 mars 1966, jour de mariage princier.
« […] La mise en scène, on aimait ça. Avec les copains on y allait assez franchement et on se marrait bien. C’était Robert Jasper Grootveld qui nous avait donné le goût des rassemblements bigarrés. Lui, il avait organisé quelques années plus tôt des drôles de cérémonies au Spui, devant la statue du Het Lieverdje. Grimé, il gigotait en vociférant des sortes de psaumes anti-tabac, anti-pub et pro-marijuana. Et tout le monde reprenait en cœur en piaffant « Kanker, Kanker, Kanker. » Les flics aimaient pas trop parce qu’on commençait à empiéter sur la rue et ça gênait la circulation, tous les samedis ! C’est là qu’on s’était rencontrés. C’est là qu’on avait chahuté les premières fois avec la police. Bon, là et aussi dans les manifs contre la guerre au Viêtnam. Mais enfin, ces rituels on les aimait bien et on en a fait petit-à-petit des sortes de forums un peu politiques. Et puis, on a poussé un peu plus loin les manifs-happening et l’agitation.
Un de nos plus beaux coups d’éclats, ça a été la tentative de saccage du mariage de la princesse Beatrix de Hollande avec Claus von Amsberg. C’était le 10 mars 1966.
On avait un peu préparé la chose, faut dire. Ça faisait déjà un bout de temps qu’on pouvait pas encadrer le promis. Le Claus, il avait été membre d’une organisation nazi dans sa jeunesse, alors le voir entrer à la tête de la Hollande, on trouvait ça gonflé. À vrai dire, la royauté on pouvait pas la voir en peinture, mais là c’était le pompon. Et on était pas les seuls à être mécontents. Alors on avait déjà perturbé la « présentation officielle ». Claus et Beatrix s’étaient baladés dans les canaux devant le bon peuple d’Amsterdam, et nous on s’était marrés à balancer des tracts sur leur passage. Elle pensait que c’était des messages de félicitation. Elle a vite déchanté !
En signe de protestation contre le mariage princier, on avait décidé que la journée du 10 mars deviendrait la « Journée de l’anarchie », comme l’annonçait cette affiche de Willem.
Et puis on s’est organisé pour le grand jour.
Le premier acte était plutôt drôle. Quelques uns d’entre nous sont allés boire des verres dans un bar de journalistes. En bavassant l’air de rien, ils se marrent à voix haute en se racontant comment ils allaient, ce fameux 10 mars, droguer les chevaux de la police en leur donnant des sucres contenant du LSD. Ni une, ni deux, les journaleux tombent dans le panneau et la rumeur fait les gros titres ! Panique en haut lieu !
Le deuxième acte s’est joué pendant le cortège. Des copains avaient préparés des fumigènes artisanaux et ils les ont lancés sur le passage du carosse nuptial. Et ça gueulait et ça piaillait ! Des trucs et des machins étaient balancés dans tous les sens ! On a même vu un poulet — l’oiseau hein — être projeté dans la confusion. Pendant ce temps, des bruits de mitraillages sont diffusés par hauts-parleurs. Tatatata tatata ta tatatata. Et d’autres copains et copines encore qui gueulaient en rythme « Ein, Zwei. Ein, Zwei. Ein, Zwei. Ein, Zwei ». Ritournelle de marche militaire comme marche nuptiale. Ils ont dû apprécier, les encouronnés ! Et la télé a bien galéré à faire en sorte que ça ne se voit pas dans les images diffusées en directe. On a beaucoup ri ce jour-là. Mais on a un peu ramassé derrière aussi !
Qu’à cela ne tienne, on en a fait le troisième acte de notre théâtre de rue. À peine dix jours plus tard on a réussi à ouvrir une exposition de photographies qui montraient les violences policières contre les manifestants. Évidemment les uniformes ont pas aimé et on est entré en pleine mise en abîme : la police violente pour empêcher une exposition qui montre la police violente. D’un point de vue artistique c’était plutôt bien vu. Mais d’un point de vue médical on était quand même un peu plus mitigé. Qu’importe c’était une belle journée de printemps. […] »